Européennes : mobilisation contre les violences numériques de genre
#GirlsWantCyberJustice
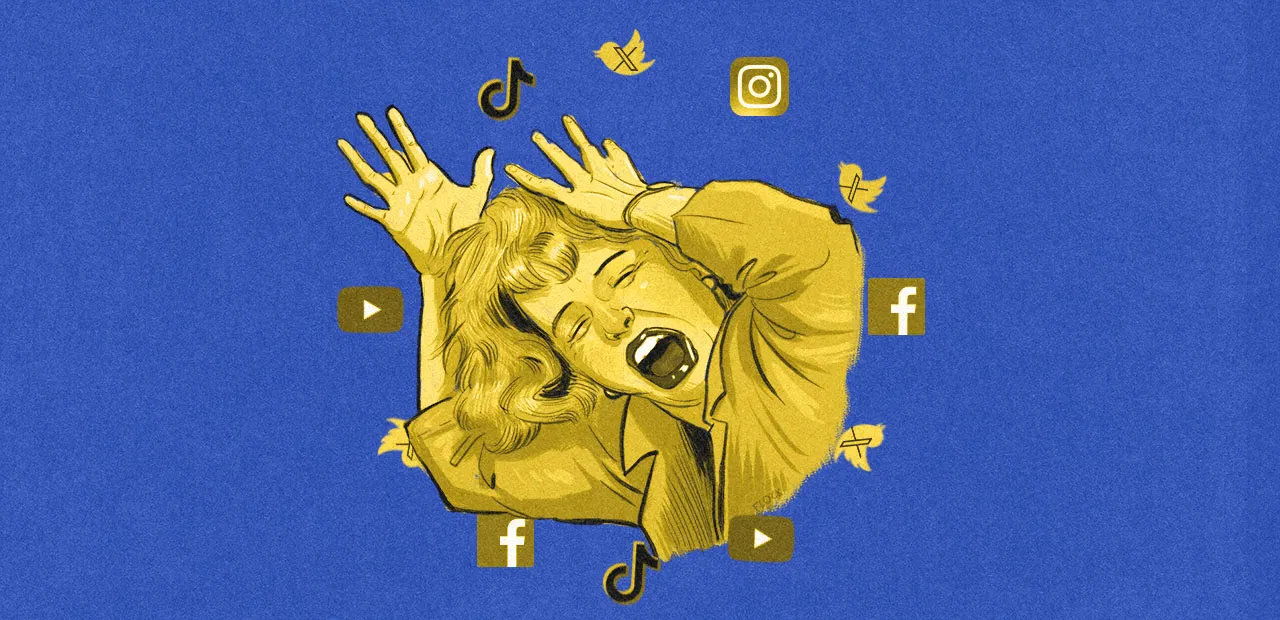
Avec #GirlsWantCyberJustice, une dizaine d'activistes européennes appellent les (futurs) parlementaires européens à lutter contre les violences numériques.
Le 29 mai à 16h31
9 min
Société numérique
Société
« En moyenne, je pense que je passe trois heures chaque semaine à gérer les suites judiciaires liées aux violences qui me visent en tant qu’élue ». Membre des Écologistes et conseillère de Paris, Raphaëlle Rémy-Leleu explique être, avec ses collègues, cible d'une attention particulière :« Ce sont des campagnes de cyberharcèlement, des insultes, des menaces, autant d’éléments qui peuvent avoir une déclinaison dans la vie hors ligne, des effets physiques, psychologiques, ou même sur nos travaux. »
La violence numérique en ligne est un danger démocratique, alertait en novembre la vice-Première ministre néerlandaise, Sigrid Kaag. À tel point que des femmes politiques sont forcées d’adapter leur comportement pour se protéger. Un des harceleurs numériques de Raphaëlle Rémy-Leleu, par exemple, s’est mis « à me suivre dans des réunions publiques. On parle de comportements inquiétants, violents, qui imposent aux femmes politiques de réfléchir à une mise en sécurité supplémentaire, des enjeux auxquels les hommes politiques ont moins affaire ».
« Les violences numériques sont des violations des droits de l'homme aux conséquences dévastatrices sur la vie des victimes, qu’il s'agisse de préjudices physiques, psychologiques, sociaux ou économiques », écrivent dans une lettre ouverte l’association française Stop Fisha, l’allemande Hate Aid, l’italienne Chayn Italia, et une dizaine d’expertes des violences numériques d’Europe de l’Ouest. Sous le message #GirlsWantCyberJustice, elles appellent les (futurs) parlementaires européens à se mobiliser sur la question des cyberviolences contre les femmes et les minorités.
Les violences numériques, un enjeu démocratique
Sans même parler des personnalités exposées – politiques, donc, journalistes, parfois devenues Prix Nobel de la Paix, artistes, scientifiques, streameuses et streamers visés par toutes sortes de campagnes de violence en ligne –, la violence en ligne a des impacts concrets dans les collèges, les lycées, comme chez les adultes.
Si les femmes y sont particulièrement exposées, précise Raphaëlle Rémy-Leleu, certains de ses collègues masculins sont aussi visés, « surtout par des cyberviolences racistes ou homophobes ». De fait, pointe la co-fondatrice de Féministes contre le cyberharcèlement Laure Salmona, les violences numériques visent « particulièrement tous les groupes minorisés, que ce soit en fonction de leur religion, de leur handicap, de leur couleur de peau ou autre », quand bien même le sexisme, le racisme, l’homophobie et les autres discours de haine sont illégaux.
Pour Raphaëlle Rémy-Leleu, ces violences lui imposent d’allouer du temps, relativement seule, à assurer sa sécurité. Mais le sujet a « des répercussions sur la société dans son ensemble », écrivent les signataires de la lettre ouverte. Pour y faire face, « des millions de femmes modifient leurs habitudes en ligne, tendent à s’autocensurer, quitter des emplois en contact avec le public et luttent pour obtenir de l’aide ».
Les effets de ces attaques, qu’elles aient lieu par le biais de campagnes de harcèlement, de publication de contenu à caractère sexuel non consenti, ou encore de surveillance forcée, sont clairs : 88 % des victimes de violences interrogées par Ipsos déclarent avoir vécu des troubles anxieux ou dépressifs, et 14 % avoir tenté de se suicider.
Un continuum en ligne et hors ligne
« Il y a souvent une tentation de séparer les deux, violences numériques et violences hors lignes, pointe Laure Salmon. Pourtant, les chiffres montrent qu’il s’agit d’un continuum », notamment au prisme du genre. Neuf victimes de violences conjugales sur dix interrogées en 2018 par le Centre Hubertine Auclert témoignaient par exemple être aussi victimes d’au moins une forme de cyberviolence.
« 72 % des victimes de violences en ligne que nous avons interrogées évoquaient une poursuite dans le monde physique, et pour une femme sur cinq, c’était sous forme de violence physique ou sexuelle » continue Laure Salmona, citant l'étude commandée par son association en 2022.
Globalement, estime Raphaëlle Rémy-Leleu, « il y a un problème dans la prise en charge des victimes de violences sexistes et sexuelles en France ». Pour le cas spécifique des élus, elle compare sa situation à celle de ses collègues néerlandais : « S’ils sont visés par ce type de violence, ils n’ont qu’à transférer les messages reçus à une adresse email, toujours la même, et les procédures qui peuvent en découler sont prises en compte par la collectivité. En France, on est très loin du compte. »
Un modèle économique qui profite de la violence ?
Outre appeler à une meilleure considération des violences numériques et leurs victimes, les activistes de la campagne #GirlsWantCyberJustice estiment le modèle économique des grandes plateformes problématique : « Ces acteurs privilégient le profit à la sécurité, perpétuent et profitent de comportements problématiques et permettent aux auteurs d'agir dans un sentiment d’impunité. »
Citant le cas d’un de ses cyberharceleurs, la co-réalisatrice du documentaire #SalePute et autrice de l’ouvrage Cyberharcelée, 10 étapes pour comprendre, Florence Hainaut, rejoint leur volonté de sensibiliser les parlementaires de l'Union européenne : « la justice belge essaie de l’identifier, mais elle se heurte au fait que certaines plateformes refusent purement et simplement de collaborer. Il n’y a qu’au niveau européen qu’on a la force de frappe nécessaire pour s’imposer face à ces acteurs. »
Parmi leurs recommandations, Shanley Clemot McLaren, Silvia Semenzin, Clare McGlynn, Elisa Garcia-Mingo et leurs cosignataires appellent précisément la Commission européenne et tous les États membres à adopter une approche sensible au genre et aux autres discriminations lorsqu’ils étudient la bonne application de textes comme le Digital Services Act ou l’AI Act par les acteurs du numérique.
Et de pointer le rôle spécifique de plateformes comme Telegram, « pas désignée comme VLOP », mais qui devrait, selon elles, « être tenue responsable des risques systémiques qu’elle amplifie en matière de violence numérique » (le qualificatif de grande plateforme créé par le DSA s’applique aux services comptant plus de 45 millions d’utilisateurs au sein de l’Union européenne, mais Telegram déclare n’en compter que 41 millions). De même, pointent-elles, des moteurs de recherche « comme Google participent à soutenir le modèle économique des entreprises malveillantes en indexant dans leurs résultats de recherche d'images les sites web qui diffusent des abus de deepfake ou des images intimes non consensuelles ».
Des fonds et l'interdiction des diffusions non consenties
Elles proposent aussi d’autres pistes aux parlementaires européens. L’une consiste à étendre le champ d’application de la Directive européenne sur la lutte contre les violences faites aux femmes pour que celle-ci intègre, dans son pan numérique, l’interdiction de diffusion de « tous les deepfakes sexuellement explicites et les nus générés par l'IA sans consentement ». Elles appellent aussi à modifier le texte « pour couvrir toutes les menaces de diffusion d'images intimes sans consentement, quels que soient les motifs ou les objectifs de l’auteur ».
Saluant l’initiative, Laure Salmona invite tout de même à la plus grande attention, pour éviter « que la lutte contre les cyberviolences ne soit instrumentalisée par les états à des fins de surveillance ». Le risque : « que toutes les lois et réglementations mises en œuvre ne soient en réalité utilisés pour mettre fin à l’anonymat, ou réduire la liberté d’expression de certaines catégories de population ».
Comme de nombreuses associations de terrain, les signataires de la lettre ouverte demandent enfin des fonds pour faciliter la prise en charge des victimes de violences numériques et la recherche sur le phénomène et ses solutions. En pratique, elles appellent à simplifier les processus de demande d’aide financière, notamment auprès de la Commission européenne, souvent trop complexes pour que les petites entités y recourent.
De concert avec Raphaëlle Rémy-Leleu, Florence Hainaut souligne un autre levier d’action supranational : celui de la Convention d’Istanbul : « outre les nouveaux textes, comme le Digital Services Act, qu’il faut appliquer, la Belgique, la France et la plupart des pays de l’Union européenne sont signataires de cette Convention, dans laquelle il y a tout un pan dédiée aux violences numériques. Quand est-ce qu’on l’applique ? La plupart de ces pays ont aussi des lois sur les discours de haine. Quand est-ce qu’on les applique ? »
« Sans traduire l’intégralité des cyberharceleurs en justice, parce que ce serait impossible en termes de temps comme d’argent, il faut que certains soient ouvertement traduits en justice » pour faire baisser l’acceptabilité de ces pratiques, continue-t-elle. Et de souligner à nouveau le rôle de moteur que l’Union européenne peut jouer auprès des États membres qui traineraient à prendre le problème au sérieux.
Européennes : mobilisation contre les violences numériques de genre
-
Les violences numériques, un enjeu démocratique
-
Un continuum en ligne et hors ligne
-
Un modèle économique qui profite de la violence ?
-
Des fonds et l’interdiction des diffusions non consenties
Commentaires (1)
Vous devez être abonné pour pouvoir commenter.
Déjà abonné ? Se connecter
Abonnez-vousLe 02/06/2024 à 10h18
C'est possible en France de faire un système où une entreprise porte plainte au nom d'une victime et récupère un pourcentage des dommages et intérêts qui lui sont versés ?